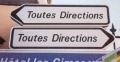
La motion de censure déposée contre « la politique sociale du gouvernement » nous a valu un débat sans intérêt supplémentaire sur les questions de « modèle social ». Mais l’Assemblée nationale n’est pas la seule concernée; les discussions de « modèles sociaux » envahissent l’espace, en France ou dans le reste de l’Europe, la mode actuelle étant la « flexicurité » type pays nordiques, vers laquelle chacun devrait tendre pour se trouver au nirvana de la compétitivité de marché sociale économique solidaire à haute valeur ajoutée. Superbe discussion, promise à noircir des pages, pour un résultat nul. Nos problèmes sont économiques avant d’être sociaux.
Qu’on ne se trompe pas : écrire cela ne signifie pas que les questions sociales sont sans importance, ou qu’il n’y a pas matière à s’interroger sur le fonctionnement des systèmes sociaux français et européens. Dans le domaine social, il y a trois problèmes principaux : l’adaptation des systèmes sociaux au vieillissement des populations, les conséquences et la maîtrise de la croissance des dépenses de santé, et améliorer le fonctionnement du marché du travail de façon à éviter que certaines catégories de la population n’en soient exclues. Vaste programme… Qui n’a strictement aucune chance d’être réalisé correctement sans une croissance économique forte.
Il y a plusieurs raisons à cela. La première est bien évoquée dans « the moral consequences of economic growth » (les conséquences morales de la croissance économique) que nous commenterons ici très bientôt, c’est que les réformes sociales ont tendance à faire potentiellement des gagnants et des perdants. Si une nouvelle dépense sociale est engagée par exemple, elle génère des coûts pour certains et des avantages pour d’autres. En période de forte croissance économique, ce type d’arbitrage est plus facile à faire, car la croissance fait que ceux qui y perdent sur le moment voient quand même leur prospérité s’améliorer. De la même façon, l’inquiétude légitime générée par des réformes du marché du travail est tempérée dans une période de forte croissance, qui implique un marché du travail dynamique. L’auteur montre dans son livre que les périodes de forte croissance ont, en général, coincidé avec les moments durant lesquels les réformes politiques et sociales les plus bénéfiques et pérennes ont été menées.
La seconde raison est liée à la mondialisation, qui rend nécessaire et possible un fonctionnement plus flexible des économies de marché et des politiques économiques. Cette flexibilité accrue a pour conséquence immédiate de créer un besoin de sécurité et de protection accru de la part des gens : cela fait qu’il est préférable, si l’on veut mener des politiques visant à adapter les pays à la mondialisation, de privilégier la libéralisation des marchés de biens et des capitaux aux réformes sociales qui amplifient l’anxiété des gens.
La troisième raison, c’est que les modèles sociaux ne sont pas des couleurs de cravate qu’on change en fonction de la mode, mais sont liés intimement aux sociétés nationales et à leurs spécificités. Le modèle social « nordique » est peut-être adapté à des populations homogènes et peu nombreuses; il n’a que peu de chances de fonctionner dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne caractérisés par des disparités régionales considérables. On peut s’interroger de la même façon sur l’exportabilité du modèle « britannique » en Europe continentale. A l’appui de cette idée, on peut citer le récent ouvrage d’Alesina et Glaeser (qui lui aussi devrait faire incessament l’objet d’une chronique dans ces pages) qui montre à quel point les caractéristiques nationales déterminent les systèmes sociaux. Ou ce récent article de Cahuc et Algan dans lequel ceux-ci exposent l’idée selon laquelle un degré élevé de sens civique est la condition nécessaire du fonctionnement de la « flexicurité » danoise, degré élevé de sens civique que l’on rencontre dans de petits pays homogènes, pas dans les grands pays européens continentaux aux populations beaucoup plus diverses.
En d’autres termes, débattre gravement des avantages et inconvénients de divers « modèles sociaux », de la nécessité d’adopter tel ou tel aspect d’expériences étrangères, et chercher à réformer le système social est inutile et nuisible sans le préalable d’une croissance économique forte, condition du succès et de l’acceptation de changements qui n’ont vocation qu’à rester des adaptations, pas des modifications radicales des systèmes sociaux. Mais, me direz-vous peut-être, ne peut-on pas considérer que les réformes des systèmes sociaux sont le préalable indispensable à la croissance économique? Notre degré de protection sociale trop élevée, nos marchés du travail rigides, ne sont-ils pas le principal obstacle au retour de la croissance en Europe?
Probablement pas. La diversité des situations en Europe montre surtout qu’un système social, même conséquent, n’est pas un obstacle pour la croissance économique. Il y a après tout en Europe toutes les combinaisons de degré de protection et de niveaux de croissance, sans que l’on puisse y distinguer une tendance claire. Si la protection sociale est un obstacle à la croissance, on comprend mal la croissance des pays nordiques aujourd’hui, ou le fait que l’Allemagne, la France et l’Italie croissaient plus vite que les pays anglo-saxons jusqu’aux années 90, ou la divergence importante entre l’Allemagne et l’Autriche. Peter Lindert a montré dans « growing Public » que la protection sociale ne semble pas nuire considérablement à la croissance depuis qu’elle existe. Il est clair que des marchés du travail peu flexibles, et de hauts niveaux de prélèvements sociaux peuvent contraindre la croissance : mais il ne semble pas que les raisons de l’eurosclérose soient à chercher de ce côté-là.
Ou sont-elles alors? Dites « rigidités » à propos de l’Europe, tout le monde vous répondra « marché du travail ». C’est oublier d’autres domaines dans lesquels ces rigidités sont beaucoup plus fortes que des marchés du travail qui ont connu d’ores et déjà de multiples adaptations et réformes. Mais les marchés de biens, de services et de capitaux en Europe, devraient faire l’objet d’un examen autrement plus attentif. Car c’est dans ces domaines que la concurrence en Europe fait l’objet des plus grandes restrictions.
The Economist consacrait récemment plusieurs articles à l’arrêt de l’ouverture à la concurrence de la distribution d’énergie en Europe; L’affaire Mittal-Arcelor, l’affaire Fazio en Italie, les réactions espagnoles à l’offre d’achat d’Endesa par Eon, montrent que les gouvernements européens sont particulièrement opposés à des opérations de restructurations d’entreprises qui ne vont pas dans le sens de la constitution de « champions nationaux ». Le gouvernement français développe une rhétorique du « patriotisme économique » qui consiste surtout à transformer le chef de l’Etat en VRP et à bloquer les entrées d’étrangers dans le capital d’entreprises « stratégiques », secteur tellement large qu’il inclut même… les sociétés de casinos. L’essentiel de la politique commerciale française consiste à préserver l’imbécile politique agricole commune. Les récentes polémiques sur la libéralisation des services, ayant abouti à une libéralisation à l’étendue considérablement restreinte. Les mouvements de main d’oeuvre à l’intérieur de l’Union Européenne sont encore extrêmement limités.
En bref, sans se lancer dans la rhétorique boursouflée tendance agenda de Lisbonne, il y a largement de quoi, en Europe, mener des réformes économiques conséquentes, qui auraient pour effet principal, pour une fois, de faire peser le poids de la compétition sur les entreprises plutôt que sur les salariés. Libéraliser les systèmes financiers des pays européens; ouvrir les économies européennes à la concurrence; Voilà de quoi bien remplir un programme de réformes économiques susceptibles d’élever le potentiel de croissance des économies nationales en Europe (pour faire bon poids, on pourrait y ajouter un mécanisme de coordination des politiques macroéconomiques des gouvernements et de la BCE différent du caricatural pacte de stabilité). Car, comme le montre un récent livre commenté par Martin Wolf dans le Financial Times (€), sur le long terme, c’est la concurrence sur les marchés de biens qui est le principal déterminant de la croissance de la productivité.
Pourtant, il n’y a aucune chance de voir ces sujets abordés dans le débat public, que ce soit en France ou en Europe. Dans le cas français, on peut expliquer cela partiellement par la priorité donnée dans l’approche des problèmes nationaux à une certaine vulgate sociologisante. Mais la principale raison tient plutôt au corporatisme et à la rhétorique de la compétitivité qui constituent l’alpha et l’oméga de la pensée économique Européenne. Pour les gouvernements français ou allemands, la mondialisation se limite à une seule chose : le problème de la compétitivité des grandes entreprises nationales. Face à ce problème, il n’y a qu’une seule sorte de choses à faire : subventionner et protéger de la concurrence et des convoitises étrangères ces entreprises, et rétablir leur compétitivité en taillant dans les coûts salariaux. C’est à cela que se résumaient les « réformes » de Shröder, tout comme les contrats Villepin.
Le résultat? Des réformes sociales mal conçues, mal mises en application, dont l’effet n’est que de pénaliser les salariés sans le moindre effet sur les taux de chômage. Le tout sur fond de programmes mal fagotés et verbeux conçus par une commission européenne médiocre, de déficits publics croissants, de croissance économique anémique. Et un débat fantasmatique sur des « modèles sociaux » qui ne mènera à rien. Les politiques authentiquement utiles qui rétabliraient la croissance en Europe nécessiteraient d’aller à l’encontre des intérêts constitués, de cette clique administrative, politique et industrielle qui détermine en pratique les politiques économiques en Europe, dont l’ineffable Thierry Breton est l’exemple caricatural. Cela exigerait aussi de comprendre que la mondialisation et la concurrence sont des forces positives pour les populations, et que « protection sociale » n’est pas la traduction française de « corporate welfare ». On peut toujours rêver.