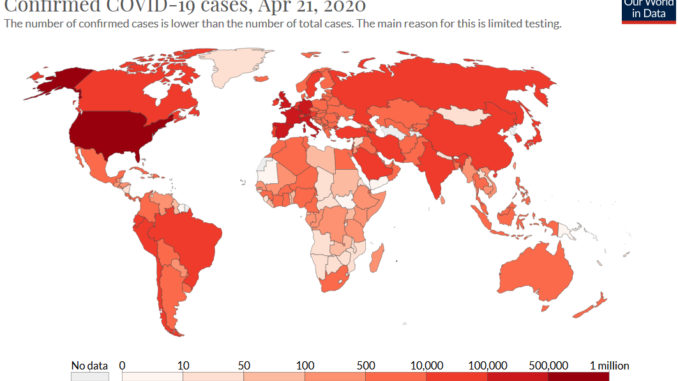

Après un mois de télétravail intense, j’ai enfin pu reprendre un peu de temps pour lire et même vaguement réfléchir. Il n’en ressort pas des choses extraordinaires, surtout pas une théorie générale des pandémies. La masse de publications sur le sujet me dispense de vous resservir ce que d’autres ont déjà clairement écrit. Ce billet présente juste quelques idées sommaires sur certains aspects de la situation. Je ne vous expliquerai pas ce que sera le monde d’après. Je n’ai rien lu de convaincant sur le sujet et je préfère m’intéresser à ce qui se passe ou se passera à court et très moyen terme. Place donc au bloc-notes.
L’absence des robots
Un aspect de la crise économique due au confinement qui peut être soulevé est l’insuffisante présence des robots dans certaines activités. Si des robots livreurs étaient opérationnels, si des véhicules autonomes étaient largement en circulation, une partie de nos difficultés seraient réduites. Si Amazon pouvait encore davantage se passer de personnel dans ses entrepôts, son activité ne ferait pas l’objet de tensions quant à la dangerosité de ses opérations pour ses salariés et pourrait continuer dans de meilleures conditions. L’automatisation d’une partie du travail des soignants serait également une bonne chose.
Il ne s’agit pas de dire « il aurait fallu » ou « on aurait dû ». La période nous rappelle simplement que les liens entre travail humain et machines sont complexes. Sur le sujet, on peut se reporter aux travaux de David Autor et ses co-auteurs. Un emploi est un ensemble de tâches plus ou moins complémentaires. Certaines sont mieux assurées par les machines que les hommes ; pour d’autres, c’est l’inverse. Les humains excellent dans les tâches réclamant de l’intuition, de la créativité et les capacités de communication complexe. C’est aux machines qu’il faut attribuer les tâches routinières qu’un algorithme peut modéliser simplement.
Dans la longue liste des opérations où les machines sont plus performantes que les humains, on peut désormais ajouter celles qui exposent à un risque viral. L’ajouter dans le sens où sa pertinence se révèle pleinement. On notera évidemment qu’il ne s’agit que d’une variété du risque plus général de santé au travail. Dans ce domaine, les applications robotiques ne sont évidemment pas nouvelles : des drones militaires aux robots secouristes l’usage de robots permettant de préserver la santé physique des travailleurs n’est pas une découverte. Le risque épidémique est néanmoins un risque à part, on le mesure actuellement. C’est une nouvelle opportunité d’exploitation des complémentarités hommes-machines qui se présente aujourd’hui.
Inspiration, pas transpiration
Dès que la certitude d’une grave récession due au confinement a été entérinée, des voix se sont élevées pour envisager que la reprise de l’activité s’accompagne d’une élévation des horaires de travail des salariés. L’analogie avec une économie post-guerre a été utilisée pour justifier ce type de mesures transitoires. Il en a résulté une courte polémique dont l’enjeu était finalement de savoir qui devrait porter l’effort de rattrapage du niveau de production, pas le cadre réel dans lequel devait s’opérer ce rattrapage.
Il me semble que la comparaison avec une économie de sortie de guerre n’est pas satisfaisante. À la fin d’une guerre, l’outil de production physique est très fortement dégradé. Rien qui puisse ressembler à un bombardement ne devrait toucher la France cette année. En l’état actuel des choses, l’effort économique qui devra être réalisé n’a rien de comparable à celui de 1945. Nos infrastructures de réseaux essentiels (énergie, télécommunications, transport) sont en état de fonctionnement. Notre outil de production n’a pas été détruit. Certes, l’arrêt durable de certaines capacités de production occasionnera des coûts non négligeables dans un certain nombre de secteurs (on peut penser à la chimie, par exemple) au moment du redémarrage. Certes aussi, du capital sera détruit au travers de faillites inévitables. La durée de l’inactivité contrainte, les mesures de soutien de l’État et le rythme de la reprise le détermineront. Mais, à ce stade, il est raisonnable de dire que cette destruction de capital prendra des proportions incomparables avec ce que serait le résultat d’une guerre. Et cela fait une grande différence sur la façon d’aborder la reprise de la croissance.
Les théories de la croissance donnent un schéma d’analyse pertinent pour comprendre la problématique. Le modèle de Solow nous permet de comprendre deux points importants sur la façon dont une économie croît. Quand elle est pauvre, le simple fait d’équiper des travailleurs de capital physique engendre une forte hausse de la production et de la productivité. L’investissement dans le capital physique est alors très rentable. Mais ce mécanisme n’a qu’un temps. Équiper en capital identique des travailleurs en nombre limité par la démographie est intéressant au départ, puis de moins en moins. En gros, quand tous les travailleurs disposent du capital utile pour réaliser leur travail de façon efficace, il ne sert à rien de doubler ou tripler le capital à leur disposition. Si la croissance doit continuer, elle ne peut le faire que parce que le progrès technique permet de mieux utiliser ensemble le capital et le travail. Cet « état stationnaire » met fin à la période de croissance que Solow appelle « phase de rattrapage » et qui correspond bien, pour le coup, à ce que connaît un pays à la sortie d’une guerre. Mais très peu à ce que nous vivons actuellement.
On pourra objecter que la hausse du temps de travail est une façon d’élever la production, dans une optique de rattrapage. Une hausse du temps de travail temporaire n’est probablement pas à exclure dans certaines activités, avec un effet positif notable. Mais à l’échelle de l’économie, cet effet sera probablement limité. D’une part, la hausse du temps de travail réduit la productivité du travail. Son effet économique en est d’autant plus réduit. D’autre part, son utilisation soulève des questions de capital humain. Sans vouloir sombrer dans l’obsession des risques psychosociaux, l’élévation du temps de travail sur de nombreuses semaines (hypothèse à retenir si l’on veut que cela ait un effet réel sur l’activité), dans le contexte des tensions mentales diverses accumulées depuis presque deux mois, pose potentiellement une question de santé publique.
C’est de progrès technique, de nouvelles connaissances, dont nous allons avoir besoin. Il me semble que le modèle intéressant à transposer ici est le « premier modèle de Romer » de croissance endogène. Il s’intéresse au rôle de l’apprentissage par la pratique dans la maîtrise des outils de production. Les travaux d’aménagement des technologies de production, l’ingénierie et l’effet d’expérience sont à l’origine d’une production de connaissances qui élèvent la productivité. Ces connaissances engendrent par ailleurs des externalités, en se transmettant à d’autres entreprises, ce qui a un effet positif plus large sur l’économie en termes de productivité.
Pourquoi me caler sur ce modèle ? parce que, au fond, tout se passe comme si nous disposions de technologies (le capital, les méthodes d’organisation, etc.) qui sont devenues partiellement inadaptées à la nouvelle contrainte qu’est la distanciation sociale. Elle est incontournable. Quel que soit l’endroit où l’on placera le curseur de la protection sanitaire des personnes, il va falloir intégrer un niveau de distanciation sociale. On peut évidemment concevoir le problème en termes d’investissement dans le capital : acheter des tas de masques, de gants, etc. Mais ne serait-ce pas trop limité et peu efficient ? Que ce soit dans le domaine de la production ou sur le versant de la demande aussi. C’est particulièrement vrai dans le domaine des services. On sait qu’un des risques majeurs est que la peur du virus ne maintienne les clients à distance des lieux de consommation de services. On peut douter du fait que la simple distribution de masques règle ce problème. Il faut donc inventer des solutions pour que les facteurs de production disponibles soient exploités au mieux. J’ajouterai que l’investissement dans du capital physique peut accompagner la démarche et que des innovations en la matière seront très probablement de la partie.
Quels genres de solutions répondraient à ces besoins ? On en a déjà inventé, dans l’urgence absolue : tracer des lignes au sol, organiser des circuits de déplacement à sens unique pour que les gens ne se croisent pas dans certains commerces, etc. Les routines à venir relèveront d’idées de cet ordre, mais de façon plus élaborée. Comment aller concrètement plus loin ? Pour tout dire, je n’ai pas réfléchi au sujet, ni dans mon domaine, encore moins pour les processus des autres… Donc, je n’en sais rien. Une chose est certaine à mon sens, c’est un problème d’inspiration et pas de transpiration qui se pose désormais. Se perdre dans des débats sur le temps de travail n’est pas le principal.
La frugalité technologique
Les technologies de l’information jouent un rôle important dans le maintien de l’activité pendant le confinement. Elles sont la pierre angulaire du télétravail, de la continuité pédagogique ou simplement du maintien du contact entre personnes, au-delà du simple téléphone.
Dans l’enseignement, j’ai été comme d’autres confronté à l’inadaptation de l’équipement de certains étudiants. Dans mon cas, ce fut vraiment très marginal. Mais si l’on a beaucoup parlé de l’usage des masques fait par les Asiatiques, on aurait pu parler aussi de leur rapport à la technologie numérique. Le concept de « frugalité technologique » se rapporte à la diffusion de nouvelles technologies dans des versions basiques et fonctionnelles, sans rechercher des performances maximales. Les habitants des pays émergents, asiatiques notamment, sont dans cette logique. Beaucoup plus que nous.
Le résultat, me semble-t-il, est un sous-équipement pour de nombreux ménages, en termes de palettes de fonctionnalités. On a un bel ordinateur personnel relativement puissant, avec un écran de 13 pouces qui permet de se déplacer avec et de naviguer sur Internet. En revanche, dès qu’il va s’agir de suivre un cours à distance correctement, la taille de l’écran va s’avérer limitée. Pourtant, il suffirait par exemple d’avoir un ordinateur fixe bien plus bas de gamme, mais doté d’un écran de taille normale, ou simplement un écran à connecter au portable, pour supprimer le problème.
C’est coûteux ? Pas forcément. J’ai par exemple plusieurs ordinateurs qui tournent sous Linux et qui ont dix ans ou plus. On peut faire beaucoup de choses simples avec ces dinosaures. Il s’agit de mes anciennes machines qui ont survécu physiquement. J’utilise même un boîtier qui a 20 ans… On trouve des ordinateurs de ce type en vente pour 50 euros ou un peu plus.
Certaines personnes ont pu se retrouver dans la situation où elles possédaient un smartphone très onéreux (et très performant) mais pas d’ordinateur personnel suffisamment fonctionnel. Il ne s’agit pas pour moi de juger de la façon dont les gens allouent leurs dépenses en matériel numérique. Juste de souligner qu’une autre façon plus frugale d’envisager ces équipements serait utile pour beaucoup de Français.
Je finirai en notant que ce n’est pas propre aux ménages. J’ai découvert dernièrement comment les parcs informatiques des lycées de la région Sud (c’est probablement le cas ailleurs) étaient gérés. De façon régulière, environ 3 ans si je me souviens bien, on change les machines. Or, évidemment, celles-ci sont généralement encore parfaitement fonctionnelles dans des usages courants. La région a un contrat avec Véolia qui récupère les ordinateurs et, si j’ai bien suivi, les démantèlent pour recycler le matériel. On est donc dans une situation où la région paie quelqu’un pour démonter du matériel fonctionnel. Un matériel qui devrait, à mon sens, être donné ou vendu à des gens qui en ont besoin. Encore une fois, je ne condamne pas ces choix, je questionne leur pertinence à l’aune des problématiques du moment.
La Nature ne se venge-t-elle ou est-ce qu’on ne l’avait pas juste oubliée ?
Pour terminer, quelques mots concernant la relation établie entre la crise environnementale et le Covid-19. Pour certains, la Nature se vengerait aujourd’hui des offenses qui lui ont été faites. Beaucoup a été dit sur ce sujet et je ne veux pas me lancer dans un débat sur ce point. Simplement, il y a dix ans, dans Nos phobies économiques, nous avions déjà dit, inspirés de lectures savantes, que le risque épidémique n’avait en fait jamais disparu et qu’un concours de circonstance historiques l’avait fait passer au second rang.
« Vous avez peur des épidémies ? Vous avez bien raison… La grippe espagnole, une cousine de la grippe porcine, tua entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde entre 1918 et 1919 (certaines sources évoquent jusqu’à 90 millions de décès), au sein d’une population exténuée par la guerre. En quelques mois, elle fit bien plus de morts que le conflit qui s’achevait. Cet épisode pandémique est le plus meurtrier que le monde ait connu au cours du siècle passé. Dans la période qui suivit, les progrès médicaux rendirent très lointaine la perspective qu’une maladie puisse tuer autant de gens en si peu de temps. Certes, les conditions sanitaires étant fort différentes dans les pays riches et dans les pays pauvres, ces derniers restaient à la merci d’une épidémie (c’est encore le cas aujourd’hui). Pourtant, la question n’était pas de savoir si l’on pouvait soigner les populations, mais si l’on voulait le faire. Les vaccins et les médicaments existaient. Seules les inégalités d’accès à la santé pouvaient être à l’origine de ce type de désastres sanitaires. La fin du 20e siècle a rappelé à l’ordre le monde, y compris sa partie la plus riche, où la production de Viagra et autres pilules d’amincissement préoccupait principalement la recherche pharmaceutique. Avec le VIH d’abord, puis le H5N1 (grippe aviaire) et, aujourd’hui, le H1N1 (grippe porcine), nous découvrons que les virus sont toujours là et susceptibles de causer des dommages conséquents sur les populations humaines. L’apparition régulière de nouveaux risques viraux aux conséquences potentiellement dramatiques, dans un contexte de médiatisation sans précédent, ajoute une source d’inquiétude supplémentaire et désagréablement inattendue. »
Si la Nature se venge de quelque chose, il est certain qu’elle se venge au moins du fait que nous avions oublié que, mondialisation ou pas, réchauffement climatique ou non, nous n’avions de toute façon pas résolu le problème des virus.
Merci pour ce post: substitution capital travail, rendements décroissants et capital humain, croissance engogène avec apprentissage et incitations distorsives. Tout est bien vu. Bravo l’économie !
Mais peut être terminez vous sur une note un peu… « morale » ?
Le battement d’aile de papillon ou les distributions à queues épaisses auraient ils offert un coda plus ouvert ?
Qu’importe… Merci. Et impatient de lire votre prochain post.
Merci. Toujours un plaisir de vous lire, en particulier votre réflexion sur le manque de robots.