Dominique Goux & Éric Maurin (2012) ▼
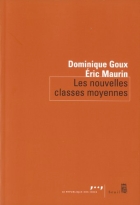
la terre entière par la portière pour rester seul en première classe"
Lofofora.
Il s'agit en premier lieu de définir les classes moyennes. Conscients que c'est là un préalable indispensable, les auteurs consacrent un chapitre entier à justifier leur définition de la classe moyenne. Cette définition repose sur l'idée qu'elles peuvent être cernées économiquement et sociologiquement même s'il en dérive certains traits politiques communs reconnus par d'autres (Serge Berstein, par exemple). Les membres de la classe moyenne sont ceux qui occupent une place intermédiaire - et potentiellement mouvante - dans l'échelle sociale. Candidats (souvent heureux) à l'ascension sociale, ils sont également ceux qui peuvent tout perdre et rejoindre le groupe d'en bas. Essentiellement salariés (les indépendants, petits patrons et commerçants ne représentent plus que 6% des actifs en 2009), ils occupent des emplois dont le niveau de qualification est plus élevé que celui des ouvriers et moins général que celui des cadres, ce qui les rend tributaires de leurs compétences spécifiques sur tel emploi, dans telle entreprise. Cette qualification spécifique est un atout et une faiblesse. Elle contribue à les stabiliser dans l'emploi et à orienter vers eux les efforts de formation professionnelle (les classes moyennes sont ceux qui bénéficient le plus de formations ; généralement orientées vers leurs compétences spécifiques). Que l'emploi occupé disparaisse et le risque de déclassement guette. Du moins dans le secteur privé, les classes moyennes de la fonction publique n'étant pas exposées de la même manière en raison de la protection des statuts (acquis par concours). Le coeur des classes moyennes est ainsi constitué des professions intermédiaires telles que l'INSEE les définit. S'y retrouvent professeurs des écoles, comptables, techniciens, représentants de commerce, cadres B de la fonction publique, contremaîtres ou infirmier(e)s. Leurs revenus sont en moyenne de 40% inférieurs à ceux des cadres et de 40% supérieurs à ceux des ouvriers. Ils représentent plus du quart de la population active et sont donc désormais le groupe le plus important de la société. Ils sont nettement plus diplômés que le souvriers, mais bien moins que les cadres. Le groupe des professions intermédiaires connaît des mouvements en son sein importants et croissants au cours du temps. La stabilité du groupe masque de nombreux mouvements individuels vers l'ascension ou la régression même si, comme l'ouvrage le montre (et comme l'avait déjà souligné Maurin) les risques de déclassement sont finalement faibles en probabilité (mais dramatiques quand ils se réalisent) et moins fréquents que les promotions. Au final, les classes moyennes sont cette catégorie sociale formée de professions intermédiaires, groupe le plus important en nombre, dont les statuts et qualifications les mettent en situation médiane, tant du point de vue des revenus que des opportunités d'évolution sociale. Animées par la peur et l'envie, elles luttent pour éviter le déclassement en visant l'accès aux statuts plus élevés.
Le chapitre suivant s'interroge sur l'évolution de la position des classes moyennes. Sont-elles déclassées, objectivement malmenées ? Les auteurs montrent qu'en nombre, leur groupe n'a cessé de croître, concluant que "la désindustrialisation et le ralentissement économique amorcés à l'orée des années 1980 ont donc contribué à ancrer davantage encore les classes moyennes au centre de la société". Leur taux de chômage est près de trois fois inféieur à celui des ouvriers (et très proche de celui des cadres). Les protections de l'emploi de cette catégorie n'ont pas baissé au cours des dernières décennies. De même, en matière de salaires relatifs, on ne note pas non plus d'érosion. Pourquoi un sentiment de déclassement salarial dans ce cas ? Goux et Maurin l'expliquent par un effet structurel. La multiplication des emplois de cadres peut se faire en maintenant des écarts entre groupes indentiques (c'est le cas). Mais de fait, la plupart des individus de chaque groupe voient leur position dans la hiérarchie des salaires reculer, notamment dans le groupe des professions intermédiaires. En d'autres termes, on se sent déclassé lorsqu'il y a plus de cadres qu'avant, même si on dispose toujours du même salaire. Qu'en est-il des expériences de déclassement effectives ? Elles sont plus nombreuses que dans l'après-guerre mais restent minoritaires, "les plans sociaux et licenciements économiques ne concernent chaque année qu'une infime minorité de salariés". La classe moyenne reste également tremplin vers l'ascension sociale, davantage qu'un point de chute pour cadres déclassés. "Parmi les salariés des professions intermédiaires en 2003, seuls 4% étaient cadres ou chefs d'entreprise en 1998 et peuvent donc être considérés comme des 'déclassés'. A l'opposé, 17% étaient ouvriers ou employés en 1998, soit des flux de promotions professionnelles quatre fois plus importants que les flux de pertes de statut en cours de carrière". Le déclassement est-il integénérationnel ? Les chiffres sont ambigus et cette question fait l'objet de plus longs développements dans le chapitre 4. Les professions intermédiaires sont-elles de plus en plus constituées de déclassés ? Il faut d'emblée souligner que la structure des emplois évoluant vers le haut au cours du temps, il semblerait logique de constater un phénomène de déclassement important. Il n'en est rien. Les déclassements intergénérationnels sont minoritaires, notamment par rapport aux situations d'ascension sociale. La classe moyenne n'est pas non plus déconsidérée. Située au centre de la hiérarchie des revenus, disposant d'une protection en regard de l'emploi et de la précarité élevée, les statuts des classes moyennes disposent d'une position intermédiaire dans l' "estime commune".
Les classes moyennes sont celles qui ont le plus à gagner et donc le plus à perdre dans la compétition scolaire. Ne disposant pas d'un patrimoine permettant d'assurer les arrières d'une progéniture vaincue dans la course aux dipômes, elles parient gros sur l'école et dépensent énormément dans le domaine. Les auteurs montrent que dans cette compétition, les classes moyennes s'en sortent particulièrement bien. Elles ont su bénéficier de la démocratisation scolaire des années 1960 au milieu des années 1980, ont su résister à la seconde vague qui a bénéficié davantage aux plus modestes en mobilisant toujours plus de ressources (notamment pour la scolarité supérieure), grignotant un peu du retard pris sur les catégories supérieures. Leur situation ne s'est donc pas détérioriée. En revanche, cette lutte pour le statu quo a généré une grande crispation dans leur rapport à l'école. Le symbole de cette frustration réside dans l'accès aux grandes écoles, qui n'évolue guère pour la classe moyenne. Le chapitre 4 s'intéresse, dans la foulée, à l'ascension sociale des enfants des classes moyennes dans la long terme, en confrontant des données générationnelles remontant à la cohorte née en 1952 (dont les informations à 30 ans sont les premières disponibles). La question est de savoir si la démocratisation scolaire dont les classes moyennes ont pu bénéficier a réellement eu un impact positif ou si les efforts des enfants de classes moyennes n'ont pas évité leur déclassement. Au départ, pour la cohorte de 1952, la proportion d'enfants de classes moyennes occupant entre 30 et 39 ans un emploi d'ouvrier ou d'employé est de 43%, ce qui est élevé. Mais les enfants de cédres nés à la même période, la proportion occupant des emplois modestes ou de professions intermédiaires est de 58%. L'étude de l'évolution au cours du temps donne une réponse est claire : aucune évolution n'est notable dans le déclassement des enfants de classe moyenne. "Parmi les enfants des classes moyennes nés en 1970 et ayant 30 ans au début des années 2000, on compte à peu près la même proportion de déclassés que parmi les cohortes nées vingt ans plus tôt et ayant eu 30 ans au début des années 1980. En d'autres termes, le risque de déclassement est assez fort pour les enfants des classes moyennes, mais pas spécialement plus élevé que naguère". Dit autrement, quand on part de haut, on risque de se retrouver bas et cette probabilité n'a pas évolué au cours du temps... En ce qui concerne la promotion sociale, la probabilité pour un enfant de classe moyenne d'accéder à la classe supérieure est longtemps restée proche de 15% avant de croître jusqu'à plus de 20% (voir ce graphique tiré du livre, p79). Après avoir constaté les fluctuations du phénomène au fil du temps (et pas seulement entre deux points), ils rappellent que ce qui a déjà été expliqué précedemment : on peut très bien percevoir un accroissement de risque de déclassement là où il n'y en a pas. Quand la part des ouvriers baisse dans la population, le déclassement tend à croître mécaniquement (puisque les ouvriers ne peuvent être déclassés) sans que le risque individuel de déclassement croisse. De même, les rangs moyens ont tendance à baisser lorsque la part des classes supérieures croît. Malgré cela, les enfants des classes moyennes ont pu maintenir leur position au fil du temps. Ce maintien et l'accès croissant aux classes supérieures est d'autant plus remarquable que, comme Goux et Maurin le soulignent à la fin de ce chapitre, il existe une forme d'inertie naturelle qui pousse les enfants à choisir comme espace social celui des parents. Chacun dispose d'atouts spécifiques dans son milieu d'origine et la mobilité sociale ascendante présente des coûts potentiels qu'on peut chercher à éviter, en optant par exemple pour le public plutôt que pour le privé, même si rémunération et statut général sont moindres.
Dans un autre domaine, celui du logement et de la course aux territoires, les classes moyennes n'ont pas démérité, loin s'en faut. Les classe moyennes seraient chassées des centres villes par les classes supérieures et menacées par la proximité grandissantes des classes modestes. En préalable, les auteurs rappellent un point que les lecteurs du ghetto français ont encore sûrement à l'esprit : la compétition scolaire passe par le logement (les meilleurs écoles sont dans les meilleurs quzartiers) et chacun cherche à mettre à distance celui qui est un peu plus pauvre que lui. Un fait saillant résume les travaux récents des auteurs (et de Nina Guyon sur ce chapitre) : la ségrégation urbaine n'a pas évolué significativement en 10 ans, comme l'illustre le tableau suivant (p100) :

Dans le détail, cependant, les mouvements sont nombreux dans les zones résidentielles. Ce qui induit des modifications du ratio riches/pauvres à l'échelle d'un voisinage. Ce que disent les données concernant les classes moyennes peut être résumé en deux points : un, les classes moyennes qui déménagent le font pour accroître la qualité de leur environnement, il s'agit de promotions résidentielles. Deux, ceux qui restent lonbtemps dans la même zone voient la qualité de l'environnement se dégrader (c'est le cas pour plus de la moitié de ceux qui ne déménagent pas en dix ans). Pour les classes moyennes, l'accès à la propriété est resté une ambition de premier plan. Mais ce patrimoine durement constitué dans des zones sujettes au déclassement résidentiel est, comme leurs qualifications ou leurs emplois, plus précaire. A tel point que, même si les auteurs ne le mentionnent pas, on peut se demander pourquoi ces gens s'accrochent à cette forme de patrimoine...
Goux et Maurin concluent le livre en réaffirmant l'importance politique de la classe moyenne décrite dans les pages qui précèdent. Elle est devenue le groupe le plus important de la société, de sorte que "passée largement inaperçue, cette évolution est tout à fait fondamentale : elle confère un rôle inédit d'arbitre à une classe sociale dont le dynamisme repose sur une capacité jamais démentie à résister au déclassement, à pousser ses enfants le plus loin possiblee, aiguillonnée paar une anxiété et une peur de déchoir sans équivalent dans l'espace social". Que faire alors en matière de politique fiscale pour tenir compte de cette place ? A bien y regarder, en dépit du double ressentiment des classes moyennes à l'égard des pauvres et des riches, il n'y aurait guère de quoi s'affoler. Certes, la classe moyenne contribue fiscalement à la redistribution. Mais quand on tient compte de certaines dépenses publiques comme l'éducation, quand on tient compte du dynamisme interne de cette classe moyenne (certains repassent dans la catégorie inférieure et bénéficient alors des transferts, pendant que certains qui en ont bénéficié et accèdent à la classe moyenne deviennent contributeurs nets), on a quelques doutes sur l'opportunité de répondre à une telle demande sur une base purement arithmétique. Les auteurs proposent néanmoins de revoir les politiques fiscales et sociales pour en finir avec les politiques de ciblage dont le défaut est double : stigmatiser (les bénéficiaires) et frustrer (les autres). L'allocation des ressources publiques devrait dans cette optique être proportionnée à des critères, davantage que concentrées uniquement sur des publics spécifiques. Même si, comme le reconnaissent les auteurs, la difficulté d'une telle réforme est considérable, pour eux, l'enjeu est essentiel : il s'agit de recréer des sécurités universelles, à même de réduire l'anxiété de la classe moyenne.
Ce livre est très bon. On y retrouve, comme toujours chez Maurin (ici accompagné d'une co-auteure régulière dans ses publications scientifiques), l'utilisation des données statistiques et autres travaux économétriques au service d'une vision sociologique inspirée qui n'hésite pas à s'orienter quand le travail d'analyse des faits et des hypothèses est terminé. L'air de rien, les auteurs nous sortent de la mêlée illisible des discours creux, des affirmations fausses et vociférations diverses. J'ajoute qu'à titre personnel, lire un nouvel opus d'Éric Maurin est toujours un grand moment parce qu'il y formalise et analyse toujours un certain nombre de questions que j'ai pu me poser incidemment. C'est évidemment un bonus pour moi (qui explique en partie sûrement pourquoi je suis un excellent client) mais, surtout, cela en dit long j'imagine sur sa façon de travailler : les yeux ouverts sur le quotidien, prêt à aller vérifier si cela se retrouve dans les données de l'enquête emploi...
Disons le aussi, même si ce n'est écrit nulle part dans l'ouvrage : il livre un portrait d'une société de rats assez méprisables, courant de plus en plus vite à l'intérieur de leur roue et n'hésitant pas à pousser les autres par dessus bord. Au fond, pourquoi se préoccuper de ces gens qui prennent un plaisir pervers à triompher dans la compétition sociale en écrasant plutôt qu'en s'élevant, la peur du déclassement pouvant tout justifier ? C'est un point de vue assez lapidaire, qui mériterait discussion et nuance, je le conçois. Mais c'est aussi une vision qu'on peut retenir du tableau dressé par les auteurs. Où se situe la limite entre la crainte légitime et la bassesse ? D'ailleurs, je laisse le mot final aux auteurs : "Comment en effet donner du contenu à un projet de justice sociale et de réduction des inégalités, quand un nombre croissant de personnes sont happés par le désir de s'élever au dessus des autres et par la crainte de déchoir, quand l'aspiration contemporaine à la singularité se confond avec une volonté pure et simple de distinction statutaire ?"
▲ Dominique Goux & Éric Maurin, Les nouvelles classes moyennes. , Seuil, 2012 (11,50 €)